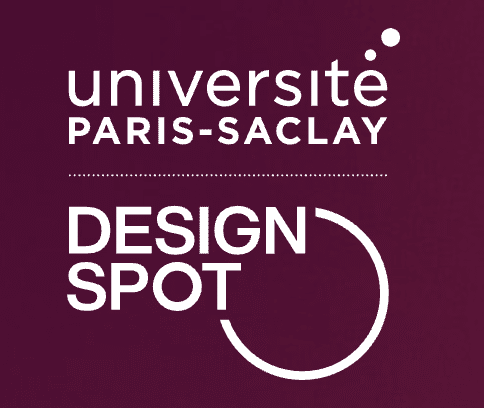Vincent Créance, directeur du Design Spot, fait le point sur l’activité de cette structure située à Paris-Saclay qui, grâce au design, a su bâtir les ponts entre recherche, financement et mise en marché de projets innovants.
Vincent Créance, comment allez-vous ?
V.C. Très bien, et c’est parce que le Design Spot se développe bien, ce qui n’était pas acquis au départ lorsqu’il a été créé, il y a bientôt sept ans. C’est que l’université n’est pas habituée en France à intégrer le design et que, de surcroît, Paris-Saclay est une institution complexe par nature, avec un centrage sur les sciences dures, assez éloignées du design au premier abord. Le retour d’expérience nous permet de dire aujourd’hui que nous sommes dans la bonne dynamique : le Design Spot est un acteur identifié dans l’écosystème, et dans toutes ses dimensions. On est très sollicité, et cela devient même difficile, car nous recevons beaucoup de demandes. À titre d’exemple, 2700 personnes ont déjà participé à nos évènements de type webinaires et plus de 150 projets ont été accompagnés en matière d’actions de conseil et d’études auprès de porteurs de projets innovants. Autre motif de satisfaction, on s’appuie sur un écosystème externe de designers professionnels et donc cela nous met sur un autre rythme qu’uniquement universitaire. Il s’agit d’un pool de 30 designers dans lequel on puise en fonction des besoins et nous avons recours en permanence à une dizaine d’entre eux. Un des faits qui montre que la greffe entre Design Spot et Paris-Saclay a prise est que nous répondons à la demande initiale : le design comme étant un moyen de mieux relier l’effort de recherche universitaire à une valorisation, et donc à des usages, à des clients et à des utilisateurs, le tout afin de trouver des débouchés plus naturels aux innovations accompagnées.
En synthèse, quelles sont les missions du Design Spot ?
V.C. Elles sont au nombre de trois : promouvoir le design au sein de l’écosystème Paris-Saclay ; conseiller et réaliser des études pour les porteurs de projets ; mener des actions de recherche et de prospective. En aidant les porteurs de projets, on le constate systématiquement, on sait convaincre de futurs partenaires, et notamment les partenaires financiers. Dans une université comme Paris-Saclay, où la recherche s’appréhende très en amont, la route est longue avant de passer à un livrable finalisé : le partenaire financier est crucial. Le design facilite beaucoup les choses, et là, on peut vraiment parler de valorisation dans tous les sens du terme.
Rappelez-nous ce qu’est Paris-Saclay
V.C. Paris-Saclay réunit cinq unités de formation et de recherche (facultés) : Droit – Économie – Gestion, Médecine, Pharmacie, Sciences, Sciences du Sport ; trois Instituts universitaires technologiques : IUT de Cachan, IUT d’Orsay, IUT de Sceaux ; une école d’ingénieur universitaire : Polytech Paris-Saclay ; quatre grandes écoles : CentraleSupélec, AgroParisTech, École Normale Supérieure Paris-Saclay, Institut d’Optique Graduate School ; deux universités membres associés : Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), Université d’Évry. Le tout sur 14 km de long avec une centaine de start-up qui se créent tous les ans. Ajoutons à cela 230 laboratoires de recherche, 9000 chercheurs et 48 000 étudiants. Paris-Saclay est à la 15e place du classement de Shanghai et première en Europe Continentale. C’est un écosystème unique en Europe et le Design Spot est, lui, un organisme unique en Europe comme centre de ressources immergé dans un écosystème universitaire.
Quelle est votre ambition pour le Design Spot dans les années à venir ?
V.C. Cela fait 39 ans que je suis un professionnel du design et je me pose logiquement la question de la transmission et de la pérennité du Design Spot. Avec l’idée sous-jacente que l’avenir du Design Spot doit suivre les grandes évolutions que l’on doit savoir décoder. Le monde change, les étudiants ont un autre regard et une autre ambition. L’avenir du Design Spot passe donc par une organisation qui sait prendre en compte ces évolutions. Il y a évidemment dans toutes ces réflexions la part que doivent prendre les systèmes alternatifs en matière de conception et de production de projet, de la place de l’IA – incontournable –, et à terme des questions plus larges sur la façon dont on va insérer des projets de recherche dans une économie différente de celle d’aujourd’hui. Ce sont ces axes de réflexion qui nous ont conduits à organiser les trois conférences regroupées dans la thématique « Les nouveaux territoires du design (cf. rubrique Évènements du design du présent numéro) ». Ces conférences sont issues en droite ligne de nos préoccupations sur le futur du design.
Justement, quelle est votre vision du design français ?
V.C. Je n’ai pas de réponse toute faite, car pour définir le design français il faudrait pouvoir définir ce que n’est pas le design français. D’autre part, je ne veux pas tomber dans les lieux communs ni répéter ce que tout le monde dit sur la qualité exceptionnelle du design français, mais il est vrai que nous avons un côté contestataire et râleur qui se satisfait mal des situations existantes. Et puis, comme nous sommes très individualistes, le design français tient à laisser sa trace. Tout ceci constitue un moteur d’innovation et de créativité, et parfois aussi de prétention. Bref, nous avons un réflexe de regard critique qui nous amène très naturellement à des propositions alternatives. C’est quelque chose que l’on retrouve beaucoup moins dans d’autres cultures.
Un message pour terminer ?
V.C. L’avenir du design en France viendra des nouvelles générations de praticiens designers et certainement pas des institutions. Ce sont ces nouvelles générations qui feront que le design épousera les besoins et contraintes de la société. Pour ce qui me concerne, j’ai beau être dans une institution, je suis dans une pratique très opérationnelle du design, et sans aucune ambition de me mettre en avant.
Une interview de Christophe Chaptal
Article précédemment paru dans le Design fax 1313